Femmes et engagement associatif:
Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est un moment de réflexion crucial sur les inégalités persistantes dans notre société. Mais au-delà de cette journée symbolique, une question demeure : qu’en faisons-nous après, des 364 jours qui restent ?
Nous sommes allé.e.s voir les expertes de l’engagement au quotidien : les associations, qui se mobilisent jour après jour pour apporter des solutions aux inégalités. Elles facilitent l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé et aux droits fondamentaux.
Sur ce terrain, de nombreuses femmes s’investissent ainsi pour faire avancer multiples causes. Une étude INJEP révèle qu’en 2021, les femmes représentaient 52 % des bénévoles et 71 % des salarié.e.s du secteur associatif.
Nous nous sommes entretenu.e.s avec des dirigeantes d’associations. Ces femmes, engagées au quotidien pour diverses causes (inclusion, environnement, droits des femmes), se confrontent aux réalités du terrain et au travail constant nécessaire pour faire évoluer les mentalités et les pratiques, peu importe la cause défendue.
Que pensent-elles du 8 mars ? Est-ce, pour elles, un simple rappel annuel ou un véritable levier de changement ? Aujourd’hui, elles partagent avec nous leurs parcours, leurs défis et leurs avis sur l’égalité femme-homme.
L’engagement, du personnel au collectif
Il y a des engagements qui naissent d’une évidence, d’un parcours personnel, ou encore d’un besoin auquel personne ne semble répondre.
C’est ainsi que Pascale Jude, Amandine Hersant, Gaëlle Nougarede, Romane Brunet et Annabelle Moulin ont choisi d’agir.
L’objectif ? Contribuer à faire évoluer les choses, en proposant des solutions pour construire une société plus juste, inclusive et durable.
Pour Amandine Hersant, Directrice Générale de Planète Urgence depuis 6 ans, l’écologie a pris place dans sa vie depuis un très jeune âge : « J’ai eu beaucoup de chance d’avoir des parents sensibilisés aux enjeux environnementaux. Mon père m’emmenait en forêt, écouter les oiseaux… Mon amour du vivant vient de là. » Elle ajoute : « On s’engage toujours en réaction à quelque chose, et moi, je me suis beaucoup engagée parce que j’ai vu des femmes en difficulté pour s’occuper de leurs enfants, j’ai vu de la violence, j’ai vu des gens qui n’arrivaient pas à vivre dignement. Au fur et à mesure que j’ai vu tout ça, j’ai voulu aller aux racines, la destruction de l’environnement, et notre incapacité à proposer un modèle de société plus durable ».

Amandine Hersant
Amandine Hersant, Directrice Générale de Planète Urgence, association de solidarité internationale et d’aide au développement qui à travers ses actions de volontariats et de sensibilisations nous donne les clés pour réconcilier les forêts, la biodiversité et l’humain.
Pour Pascale Jude, Fondatrice d’Action Passeraile, «Quand j’ai voulu intégrer une association pour être bénévole, je n’ai pas trouvé. Il n’y avait rien pour les besoins individuels de lien social des personnes handicapées. Alors je n’ai pas hésité, j’ai créé une association. Je n’avais absolument aucune idée de comment j’allais m’y prendre, comment ça allait se financer, si ça pouvait se financer. Enfin, je n’avais aucune idée de tout ça, mais après c’était impossible de faire autrement, c’était viscéral ».
Depuis sa création le 3 juin 2003, Pascale s’engage pleinement pour l’inclusion des adultes en situation de handicap. Après avoir assuré pendant 20 ans un accompagnement individuel et gratuit à Paris, elle met maintenant ses connaissances et ses compétences au service de Paris en Compagnie, et organise diverses actions de sensibilisation en entreprise.

Pascale Jude
Pascale Jude, Fondatrice d’Action Passeraile, a créé l’association en juin 2003. Depuis sa création, Action Passeraile se consacre à l’inclusion des personnes en situation de handicap moteur et visuel, en offrant un accueil et un accompagnement personnalisé lors d’événements publics.
Pour Gaëlle Nougarede, Co-Fondatrice de Movement France, c’est au Burkina Faso que son engagement a pris forme. Étant témoin de l’impact de la pollution plastique et de la vulnérabilité économique des femmes lors d’un voyage personnel, elle a trouvé sa mission : « Nous avons mis en place un programme qui permet aux femmes de transformer les déchets plastiques en objets réutilisables et vendables, leur offrant ainsi une source de revenu stable ». Aujourd’hui, son association compte une trentaine de bénévoles qui agissent pour conjuguer inclusion sociale et protection de l’environnement.

Gaëlle Nougarede
Co-fondatrice de l’association Movement France, qui œuvre à la mise en place d’actions pour la protection de l’environnement, pour la lutte contre le réchauffement climatique et la vulnérabilité économique des femmes au Burkina Faso.

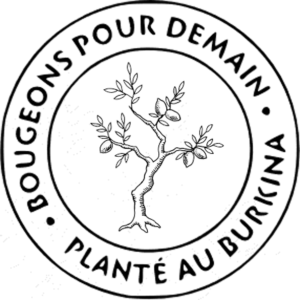
Romane Brunet et Annabelle Moulin ont, quant à elles, rejoint Eris, une association lyonnaise qui accompagne les personnes réfugiées à travers l’apprentissage de la langue et de la culture française. « L’association a été fondée en 2016 car, à l’époque, il n’existait pas de cours de français pour les demandeurs d’asile. Aujourd’hui, cette problématique est toujours d’actualité », explique Romane, Coordinatrice Générale de l’association. Grâce à l’engagement de 50 bénévoles et de plusieurs salariées, Eris propose des formations intensives de 22 heures par semaine pendant cinq mois. Le programme pédagogique et les cours de français sont du ressort d’Annabelle, formatrice; les autres ateliers ont été conçus en équipe et sont animés par des bénévoles.

Romane Brunet et Annabelle Moulin
Romane Brunet (à droite de l’image), Coordinatrice Générale et Annabelle Moulin (à gauche de l’image), Formatrice FLE au sein de l’association Eris basée à Lyon. Depuis 2016, Eris propose un lieu de vie et d’apprentissage pour les personnes exilées, conçu pour favoriser leur intégration en France.
Malgré le contexte difficile dans lequel ces associations évoluent, où la précarité ne cesse de croître, où les enjeux environnementaux occupent une place majeure dans les débats internationaux, où la question de l’inclusion des personnes handicapées reste présente et où le racisme ne semble pas reculer, ces femmes poursuivent leur engagement malgré les obstacles. « Dans mon parcours, j’ai vu la nécessité d’aller beaucoup plus vite sur les sujets environnementaux, d’où mon engagement après pour Planète Urgence. Chaque mouvement d’impact sera nécessaire pour que le monde puisse revenir dans un sens qui lui est plus favorable en termes de pérennité », affirme Amandine
Être une femme à la tête d’une association
Pascale (Action Passeraile) nous confie :
« C’est compliqué. Quand on arrive dans un milieu, quel qu’il soit, on commence souvent par être regardée de haut. Et ce n’est pas la même chose quand on est un homme, grand, avec une voix grave. Sincèrement, je l’ai remarqué à plusieurs reprises. Il a fallu des années avant qu’on m’écoute dans les réunions inter associatives…
… Mais avec le temps, à ma grande surprise, les regards ont changé. Les gens ont commencé à me percevoir différemment, en disant : Ah, tiens, c’est Action Passeraile qui parle. «Action Passeraile, avec son expérience, avec sa connaissance du terrain. »
À l’international, les contraintes sont parfois culturelles. Amandine (Planète Urgence) l’a constaté lors de certaines rencontres professionnelles : « Le fait d’être une femme et en plus de paraître jeune dans des pays où l’on valorise la séniorité crée parfois un recul. Parfois, on va d’abord s’adresser à mon directeur de pays avant de réaliser que la directrice générale est juste à côté. »
Gaëlle (Movement France), pour sa part, dit : « En tant que femme à la tête d’une association, je n’ai pas rencontré de défis particuliers pour des demandes de mécénat, de fonds ou autre. Au contraire, je trouve que c’est plutôt l’inverse. Les appels à projets auxquels nous répondons aujourd’hui incluent des règlements imposant la présence de 80 % de femmes au sein des instances de gestion sociétale, qu’elles soient entrepreneuriales ou associatives, avec également une femme à leur tête. Je ne me suis donc jamais retrouvée confrontée au fait que, parce que je suis une femme, il me soit interdit de déposer une demande de subvention au nom d’une association… »
Pour Romane et Annabelle (Eris), le fait d’être une équipe quasiment entièrement féminine change la donne : « Vis-à-vis du public, nous n’avons jamais senti de difficultés, je pense que ce qui est intéressant est que dans notre structure, l’équipe dirigeante est entièrement féminine, ce qui oblige parfois les personnes que nous accompagnons à se confronter à une autorité incarnée par des femmes. L’autorité, c’est forcément féminin chez nous. »
L’impact,
Annabelle (Eris) illustre l’impact de son travail auprès des bénéficiaires.
« On reçoit les mêmes témoignages de la part d’hommes et de femmes : « Maintenant, quand je vais chez le médecin, je n’ai plus besoin de traducteur » ou « Aujourd’hui, j’ose demander mon chemin. » » Romane, pour sa part, reconnaît que le chemin est encore long : « Je pense que nous sommes encore à la première marche de la solution, nous ne voyons pas nécessairement l’effet direct dans le changement des mentalités. Par exemple, les femmes que nous accompagnons sont encore dans la retenue, elles pensent que ce que nous accomplissons ensemble n’est pas suffisant, que le chemin n’est pas fini, que ce sera beaucoup plus difficile pour elles. »


Pour Gaëlle (Movement France), l’émancipation des femmes ne se résume pas à une rupture avec les structures sociales existantes, mais à une meilleure inclusion tout en respectant le cadre familial.
« Il faut peut-être donner plus de temps aux femmes que nous accompagnons, et en tout cas apporter de meilleurs outils. Par exemple, nous travaillons actuellement sur un projet de développement agroalimentaire en Afrique de l’Ouest. Nous avons remarqué qu’il y avait quelques femmes qui sortaient du lot sur la transformation agroalimentaire. Elles ne sont pas nombreuses comparées aux hommes, mais toutefois, elles sont quand même présentes.
Et aujourd’hui, quand nous lançons ce projet-là, nous prenons en considération tous les facteurs qui pourraient heurter la réussite de ce projet, comme la garderie. Sur ce volet-là, la garderie devient un facteur d’échec potentiel, si les femmes ne s’en emparent pas… Ensuite, nous savons que la menstruation des femmes qui revient tous les mois est un facteur aussi qui peut être cause de non-réussite.
Nous les accompagnons en leur permettant d’avoir un kit d’hygiène menstruelle qui, du coup, leur permet de sortir aussi en toute tranquillité. Tous ces facteurs-là sont des facteurs de réussite », affirme Gaëlle Nougarede.
L’enjeu n’est pas de couper les liens, mais d’améliorer les conditions de vie des femmes tout en respectant les spécificités et complexités propres à une culture. « On a tous besoin les uns des autres.
On a besoin de nos familles, on a besoin des hommes, on a besoin de nos conjoints, nos maris, nos frères », ajoute-t-elle.
Cependant, malgré ces actions visibles et ce rôle essentiel des associations, l’image des associations en France souffre encore de stéréotypes.
Amandine (Planète Urgence) regrette que leur travail soit souvent perçu comme une simple demande de financements :
« À partir du moment où on arrive en tant qu’association, notamment dans le monde institutionnel, dans les entreprises, on a l’impression que les associations sont là pour demander de l’argent et qu’elles sont presque en train de quémander, alors que ça devrait être l’inverse. Ça devrait être les entreprises et l’État qui devraient dire merci beaucoup à ce monde associatif de prendre la place que nous, on n’a pas su prendre, de réparer ce qui a été abîmé, de faire en sorte que le lien social perdure, de faire en sorte que l’écosystème perdure. Donc je trouve que le rapport, ce n’est pas tant un rapport homme-femme, c’est plutôt un rapport association d’intérêt général versus d’autres acteurs, où on a besoin de mettre plus de puissance, de légitimité, de force derrière ce secteur associatif qui est en fait celui qui répare, ce que les autres ne font pas toujours ».

Et au-delà du 8 mars ?
La Journée internationale des droits des femmes est un moment essentiel en France et à l’international. Mais ne risque-t-elle pas d’être une journée où l’on parle d’égalité avant de replonger dans une routine où les disparités persistent ?
« Je trouve que le 8 mars a un peu cet effet regain d’énergie. C’est le fait de se regarder, de se reconnaître et de se dire, on est là. Mais comme plein d’autres choses, comme les conditions de vie des personnes avec lesquelles on travaille, il faudrait que ce soit des sujets du quotidien », explique Annabelle (Eris).

Comme le souligne Pascale, « Ce n’est pas une question d’opposition entre les hommes et les femmes, mais de construire ensemble un monde plus juste ». Ce qui est partagé par Gaëlle : « Il faut vraiment avoir en tête que le partage et l’engagement bénévole, c’est quelque chose de profitable pour soi et pour les autres ».

L’évolution des mentalités est déjà en marche, notamment chez les jeunes générations. Amandine Hersant conclut : « Chez les 30-40 ans, il y a une vraie prise de conscience et une volonté d’égalité ».

Pour Pascale Jude, ce constat montre que les mentalités évoluent, malgré parfois un sentiment de recul : « À l’échelle de l’humanité, je pense qu’on a fait un bond en avant depuis 100 ans ».

Cette évolution, si bien qu’elle soit en cours, doit s’accompagner d’une réflexion plus profonde sur les enjeux écologiques et sociaux. Pour Amandine, « Évidemment qu’il faut une journée pour soutenir le droit des femmes. C’est bien que cela existe puisque ce moment permet de rassembler tous les acteurs sur une journée spécifique, au niveau des institutions, d’avoir des annonces qui sont réalisées par les États, les gouvernements, d’avoir des discussions aussi qui ont lieu au niveau des médias, donc c’est essentiel. Mais ce n’est vraiment pas suffisant, il faut aller au-delà de la journée et que ça vienne nourrir l’ensemble des discussions qu’on a à tous les niveaux, dans les entreprises, dans les États, dans les collectivités, dans le monde associatif, dans les familles… ».
Merci Amandine, Pascale, Gaelle, Annabelle et Romane pour ces échanges et vos réflexions sur les femmes et l’engagement associatif.